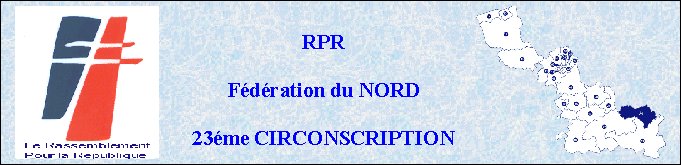
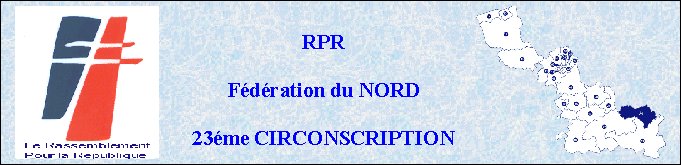
L'HISTOIRE du MOUVEMENT
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Une filiation historique |
| |||||
|
|
||||||||
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| |||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Le Rassemblement n'existerait pas sans le Général de Gaulle et sans cette voix qui, le 18 juin 1940, a refusé la défaite de la France. |
|
André Malraux a magnifiquement dit du gaullisme qu'il représentait la force du "non" dans l'Histoire, c'est-à-dire la force de la révolte contre la fatalité. C'est pour poursuivre ce combat en faveur d'une certaine idée de la France que le Général de Gaulle crée en 1947 le Rassemblement du Peuple Français (RPF). Face aux menaces qui pèsent sur la République, il accepte de revenir au pouvoir en 1958. La Ve République rend alors à la France la stabilité politique dont elle a besoin avant de restituer à chacun des Français une part de la souveraineté nationale en établissant l'élection du Président de la République au suffrage universel. Charles de Gaulle est élu président de la République le 21 décembre 1958. Réélu en 1965, la Général de Gaulle quitte ses fonctions en 1969 après l'échec du référendum sur la régionalisation et la réforme du Sénat, projet dont le caractère trop novateur avait provoqué l'hostilité d'une fraction de l'opinion. |
|
|
|
|
|
|
|
Georges
Pompidou poursuit le dessein fondamental Ainsi, pour lutter contre l'apparente fatalité du déclin industriel, il poussera plus avant encore la modernisation des structures économiques du pays et de son outil de production. Son rôle fut essentiel dans la signature des accords de Grenelle, marquant ainsi son attachement au dialogue social et à la participation des salariés à la vie de la cité. La France doit aussi à Georges Pompidou une politique extérieure clairvoyante et avisée: poursuite de la politique de dissuasion nucléaire, condition de l'indépendance nationale, politique de coopération avec l'Otan, consolidation de l'entente franco-allemande, confirmation et poursuite de la construction européenne. Avec sa disparition prématurée en 1974, le mouvement gaulliste perd la responsabilité suprême des affaires. Il n'en continue pas moins d'influencer de façon décisive la vie du pays. |
|
Georges Pompidou succède au général de Gaulle. Avec son style propre, il incarne la continuité du gaullisme. |
|
|
|
||
|
|
Jacques
Chirac fonde |
|
Jacques Chirac s'est engagé dans la vie publique dès 1967 au sein de la famille gaulliste devient ministre chargé des Relations avec le Parlement, puis ministre de l'Agriculture et enfin ministre de l'intérieur peu avant le décès de Georges Pompidou. De 1974 à 1976, Jacques Chirac est Premier ministre. Le 5 décembre 1976, il fonde le Rassemblement Pour la République (RPR) qui sera la première force politique de la majorité à l'Assemblée Nationale jusqu'en 1981 et la première force d'opposition de 1981 à 1986. De 1986 à 1988, Jacques Chirac accepte d'être à nouveau Premier ministre, dans un contexte difficile dû à la cohabitation, pour préserver les institutions, l'unité du pays et engager sans tarder le redressement et la modernisation de la France. La très large victoire aux législatives de mars 1993 donne au Rassemblement une place essentielle au sein de la nouvelle majorité. Le nouveau Premier ministre Edouard Balladur, issu de ses rangs, engage la politique de redressement de la France. |
|
|
|
||
|
|
|
Après vingt-un an d'absence, un gaulliste Jacques Chirac est de retour à l'Élysée. |
|
|
|
Le 4 novembre 1994, Jacques Chirac annonce sa candidature à l'élection présidentielle et sera élu à la présidence de la République le 7 mai 1995 avec 52,64% des suffrages exprimés. Pendant toutes ces années, le fil n'a jamais été rompu. Le mouvement gaulliste est resté fidèle à ses convictions et a refusé la fatalité du déclin de la France. Pour la première fois depuis vingt et un ans, un gaulliste est à l'Élysée. |
|
|
|
|
|||
|
|
Deux ans à peine après l’élection de Jacques Chirac, les élections législatives voient la victoire de la gauche. Philippe Séguin remplace Alain Juppé à la présidence du RPR, et entame sa rénovation. Il ouvre un large débat interne qui permet à chacun, adhérent et élu, de s’exprimer sur sa vision du Mouvement et sur son projet. C’est sur ce socle rénové que les militants adoptent de nouveaux statuts et un projet qui permettent au mouvement gaulliste de s’engager dans le troisième millénaire avec l’avancée considérable de l’élection du président par les adhérents. Après la démission de Philippe Séguin, Michèle Alliot-Marie est élue présidente le 4 décembre 1999 par 62,7% des adhérents. C’est la première femme élue à la présidence d’un grand mouvement en Europe. Le RPR fait ainsi la preuve à travers cette élection de sa maturité, de son enthousiasme et de sa volonté de se projeter dans l’avenir afin de conduire la France sur le chemin du renouveau et de la reconquête. |
|
Le RPR s'engage résolument sur le chemin de la reconquète. |